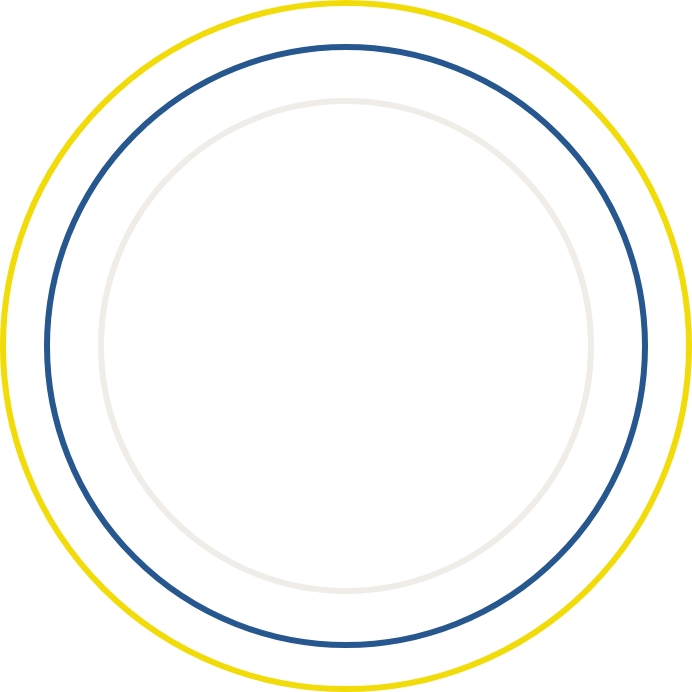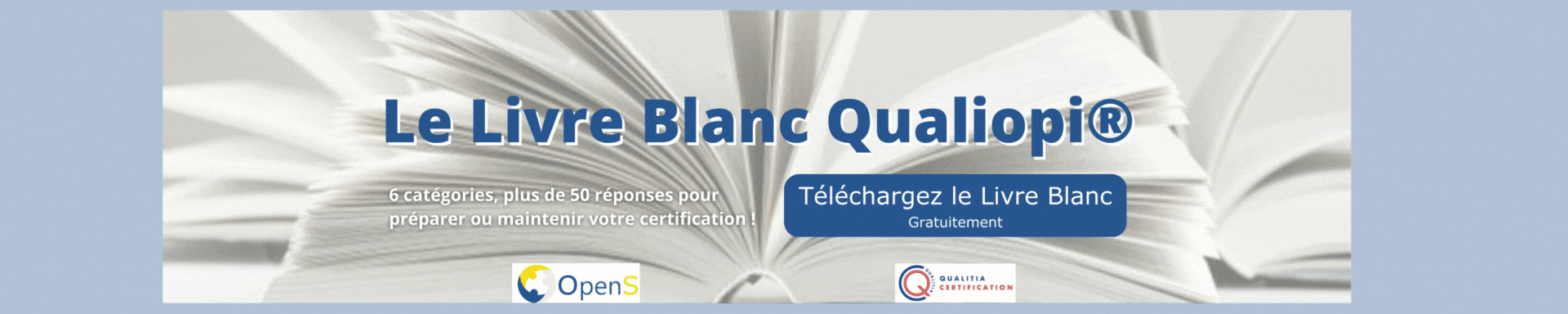Alors que l’été 2025 s’achevait sur la présentation du Plan qualité et de lutte contre la fraude dans la formation professionnelle, le mois de septembre a vu naître un nouveau gouvernement conduit par Sébastien Lecornu.
Entre continuité politique, nouvelles priorités et vigilance nécessaire, les organismes de formation se retrouvent face à un paysage réglementaire qui pourrait de nouveau évoluer.
Faisons le point sur les textes, les orientations et les points d’attention pour les acteurs de la formation professionnelle.
Le Plan qualité et lutte contre la fraude : une réforme de fond
Présenté en juillet 2025 par Élisabeth Borne, ce plan interministériel vise à assainir durablement l’écosystème de la formation professionnelle.
L’ambition affichée est double :
- garantir des formations de qualité, lisibles et transparentes ;
- instaurer une tolérance zéro face aux pratiques frauduleuses et aux dérives observées sur certains marchés, notamment ceux liés au CPF.
Le document de cadrage, diffusé par les ministères concernés, repose sur quatre grands axes :
- Renforcer la qualité des formations, notamment celles menant à une certification ;
- Mieux informer et protéger les jeunes et les actifs, en encadrant les pratiques commerciales ;
- Garantir la qualité des processus des organismes de formation, avec un référentiel Qualiopi enrichi ;
- Déployer une politique de tolérance zéro contre la fraude, coordonnée entre les administrations et les financeurs.
On vous en parle dans notre 👉 article dédié 👈
Le gouvernement Lecornu pourrait redéfinir les priorités
Le plan qualité a été conçu sous le gouvernement précédent. Or, la formation professionnelle dépend d’une chaîne politique étroitement liée aux arbitrages budgétaires et ministériels.
Depuis la nomination de Sébastien Lecornu à Matignon, une recomposition ministérielle s’est opérée : certains portefeuilles changent de mains, et les premiers discours du nouveau Premier ministre mettent l’accent sur la lutte contre toutes les formes de fraude, y compris sociale et fiscale.
En clair, la thématique reste d’actualité, mais les priorités pourraient glisser.
L’approche pourrait se recentrer sur l’efficacité budgétaire, la responsabilisation des financeurs et la simplification administrative, plutôt que sur un renforcement du contrôle Qualiopi.
Aucune communication officielle n’indique aujourd’hui une abrogation ou une suspension du plan ; cependant, le nouveau gouvernement pourrait :
- moduler son calendrier d’application (certification des auditeurs, extension Qualiopi) ;
- revoir les critères d’évaluation ou les moyens alloués aux contrôles ;
- réviser certaines dispositions législatives, notamment celles concernant les habilitations à former.
C’est pourquoi il est essentiel pour les organismes de poursuivre une veille active sur les décrets d’application, les communications de France compétences et les circulaires du ministère du Travail.
Changement de gouvernement, certes, mais le tempo législatif reste soutenu.
Deux textes, en particulier, viennent s’ajouter à la liste des actualités à suivre de près :
le projet de loi sur l’emploi des salariés expérimentés, et le projet de loi de finances 2026, dont certaines mesures pourraient redéfinir le périmètre du CPF.
Emploi des salariés expérimentés : un nouveau cadre légal et des obligations renforcées pour les entreprises
Promulguée le 24 octobre 2025, la loi n°2025-989 portant transposition des accords nationaux interprofessionnels marque une nouvelle étape dans la gestion des parcours professionnels des salariés expérimentés.
Son objectif : favoriser le maintien dans l’emploi, la transmission des compétences et la reconnaissance de l’expérience des collaborateurs en deuxième partie de carrière.
Parmi les principales mesures à retenir :
- Une négociation obligatoire tous les trois ans dans les branches professionnelles et dans les entreprises de plus de 300 salariés, portant sur l’emploi, le travail et l’amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés.
- La possibilité, pour les entreprises de moins de 300 salariés, d’appliquer un plan d’action type défini par la branche, au moyen d’un document unilatéral lorsqu’aucun accord collectif n’a pu être conclu.
- Un dialogue social renforcé autour de la fin de carrière, de la transmission des savoirs, du mentorat et des modalités d’accompagnement vers la retraite progressive ou le temps partiel.
- L’évolution de l’entretien professionnel, désormais rebaptisé « entretien de parcours professionnel » : il est organisé tous les quatre ans (et non plus tous les six ans) et aborde plus largement les compétences, les besoins de formation, les perspectives d’évolution ou de reconversion, ainsi que les conditions de maintien dans l’emploi.
- Un entretien spécifique avant 60 ans, dédié aux aménagements de fin de carrière, au passage au temps partiel ou à la retraite progressive.
La loi introduit également deux nouveautés majeures :
- La création de la période de reconversion professionnelle (entrée en vigueur au 1er janvier 2026), permettant à un salarié d’acquérir de nouvelles compétences, en interne ou en externe, tout en sécurisant son parcours.
- L’expérimentation du contrat de valorisation de l’expérience, ouvert pendant cinq ans aux demandeurs d’emploi âgés d’au moins 60 ans (ou 57 ans selon les branches), afin de faciliter leur retour à l’emploi via un CDI spécifique.
On vous en parle 👉 ici 👈
Le financement des bilans de compétences par le CPF, menacé
Alors que la formation professionnelle poursuit sa transformation, une nouvelle inquiétude émerge autour du projet de loi de finances 2026.
Celui-ci pourrait supprimer l’éligibilité des bilans de compétences au Compte personnel de formation (CPF) — une mesure qui, si elle était adoptée, modifierait profondément l’accès à l’accompagnement professionnel pour des milliers d’actifs.
Cette perspective a suscité une mobilisation inédite des organisations représentatives du secteur : la Fédération nationale des CIBC, les Acteurs de la compétence, le Synofdes et la FFPABC ont publié un appel commun pour alerter sur les conséquences sociales et économiques d’une telle mesure.
Leur message est clair : se priver du bilan de compétences reviendrait à fragiliser un levier central de l’orientation et de la reconversion, au moment même où les mutations du marché du travail s’accélèrent.
Selon la Dares, les formations relevant du “développement des capacités d’orientation, d’insertion ou de réinsertion professionnelles” — catégorie incluant les bilans de compétences — représentaient 6,2 % de l’ensemble des formations réalisées en 2023.
En 2024, ces actions ont concerné près de 6 % des dossiers CPF et 7,4 % des montants engagés, confirmant leur poids réel mais mesuré dans le dispositif.
Pour les acteurs du secteur, le bilan de compétences demeure un outil ciblé, utile et non inflationniste, qui ne “cannibalise” pas les fonds du CPF.
Ces acteurs ont ouvert une pétition que vous pouvez retrouver sur le site de l’Assemblée Nationale
Une suppression aux effets systémiques
Les professionnels alertent sur une triple conséquence si la mesure entrait en vigueur :
- un frein à la reconversion pour les actifs sans financement personnel,
- une menace économique directe pour les structures spécialisées, souvent de petite taille,
- et une rupture d’égalité d’accès pour les publics les plus fragiles : seniors, femmes, personnes en longue maladie ou en transition de carrière.
Un dispositif historique et encadré
Créé par la loi du 31 décembre 1991 et consolidé par la loi Avenir professionnel de 2018, le bilan de compétences bénéficie d’un cadre réglementaire solide, avec des prestataires labellisés et une méthodologie encadrée par décret.
Les organisations plaident donc pour une structuration durable du marché plutôt qu’une suppression du financement.
Elles appellent le gouvernement à privilégier un encadrement qualitatif des prestataires et une meilleure régulation des offres, plutôt qu’une restriction d’accès pour les bénéficiaires.
Une question toujours en débat
À ce jour, rien n’est encore voté : le projet de loi de finances 2026 suit son parcours parlementaire et devrait être débattu dans les semaines à venir.
Mais la proposition s’inscrit dans une tendance budgétaire amorcée par la loi de finances 2025, qui avait déjà exclu du CPF certaines formations à la création ou reprise d’entreprise.
Le risque de voir les bilans de compétences subir le même sort est désormais pris au sérieux par l’ensemble des acteurs de la filière, qui appellent à un dialogue de fond avec les ministères du Travail et de l’Économie.
Sous-traitance Mon Compte Formation : un nouveau cadre à 80 % désormais en vigueur
Depuis le 1er avril 2024, les organismes de formation référencés sur MonCompteFormation (MCF) sont soumis à une règle précise : ils doivent réaliser eux-mêmes au moins 20 % du chiffre d’affaires généré sur la plateforme, et ne peuvent donc sous-traiter plus de 80 % de leur activité.
Ce changement, inscrit dans l’arrêté du 3 janvier 2024 et à l’article R.6333-6-2 du Code du travail, s’inscrit dans la volonté de renforcer la transparence, la traçabilité et la responsabilité des organismes vis-à-vis des bénéficiaires comme de la Caisse des Dépôts.
Un calcul encadré et normé
Taux de sous-traitance = (CA sous-traité sur MCF ÷ CA total sur MCF) × 100
Quelques précisions essentielles :
- le calcul porte exclusivement sur les actions réalisées via MonCompteFormation,
- la marge du donneur d’ordre est incluse : l’assiette de calcul est le CA facturé à la CDC, et non le montant versé au sous-traitant,
- les acomptes non réalisés, formations annulées ou prestations annexes (licences e-learning, centre d’examen, etc.) sont exclus du calcul.
Période de référence :
- pour 2024 : du 1er avril au 31 décembre 2024 ;
- à partir de 2025 : sur l’année civile complète.
Chaque organisme devra déclarer annuellement ce taux via le portail EDOF, au cours du premier semestre de l’année suivante.
Une règle qui vise à assainir le marché
Cette mesure ne relève pas d’une contrainte administrative de plus : elle poursuit un objectif stratégique clair.
En limitant la sous-traitance, le gouvernement cherche à endiguer les pratiques de portage Qualiopi et les montages en cascade, où le prestataire de formation initial ne réalise plus lui-même les actions vendues.
Derrière cette règle se trouve un principe fort : le donneur d’ordre doit être un acteur de la formation, pas seulement un intermédiaire commercial.
C’est un levier supplémentaire pour revaloriser les organismes réellement engagés dans la conception pédagogique, l’animation et l’évaluation des formations.
Des impacts directs pour les responsables Qualité
Pour les équipes Qualité, cette réforme change la manière de piloter la conformité et de documenter la sous-traitance.
Trois points d’attention se dégagent :
1. Suivre le taux de sous-traitance tout au long de l’année
Le ratio devient un critère de maintien du référencement sur MCF.
Un suivi mensuel du taux (CA sous-traité / CA total MCF) permet d’anticiper les dépassements et d’ajuster la planification des sessions.
2. Renforcer la traçabilité contractuelle
Chaque prestation sous-traitée doit être formalisée par un contrat, mentionnant :
- les missions confiées ;
- les conditions financières ;
- les exigences Qualiopi applicables au sous-traitant ;
- et les preuves d’exécution (feuilles de présence, évaluations, livrables).
Ces documents constituent la base de preuve à conserver pour la déclaration EDOF et en cas de contrôle de la Caisse des Dépôts.
3. Adapter la stratégie commerciale
Les organismes historiquement positionnés sur un modèle de portage ou de mutualisation de formateurs devront repenser leur structure : soit en intégrant davantage de prestations en interne, soit en rééquilibrant leurs volumes de sous-traitance pour respecter le seuil de 80 %.
Ce nouveau plafond s’inscrit dans le même esprit que le Plan qualité et lutte contre la fraude publié en juillet 2025 :
créer un écosystème où la qualité d’exécution et la maîtrise pédagogique priment sur la simple détention du référencement.
La sous-traitance reste autorisée, mais elle doit être maîtrisée, justifiée et traçable.
En d’autres termes, le « faire-faire » n’est pas exclu, mais il ne peut plus constituer la norme.
Certifications, répertoires, critères d’enregistrement : le décret qui redessine le paysage RNCP et RS
L’été 2025 n’a pas seulement apporté un plan de lutte contre la fraude : il a aussi transformé en profondeur le cadre de la certification professionnelle.
Le décret n° 2025-500 du 6 juin 2025, publié au Journal officiel, vient renforcer les exigences pour figurer au sein des deux grands répertoires nationaux :
- le RNCP (Répertoire national des certifications professionnelles), qui recense les diplômes et titres à finalité professionnelle ;
- et le RS (Répertoire spécifique), dédié aux certifications et habilitations ciblant des compétences transversales ou complémentaires.
Derrière un texte à première vue technique, se cache une évolution majeure : une montée en rigueur pour les certificateurs et un contrôle renforcé pour garantir la qualité des certifications enregistrées.
Un filtre renforcé dès le dépôt de la demande
Le décret introduit un mécanisme inédit : le refus immédiat d’une demande d’enregistrement en cas de manquement grave.
Concrètement, si un certificateur dépose un dossier comportant une fausse déclaration, un plagiat de référentiel ou une communication trompeuse, France Compétences peut désormais le rejeter sans étude approfondie.
Ce dispositif, prévu à l’article R.6113-8-1, permet d’écarter rapidement les pratiques frauduleuses ou les dépôts opportunistes, tout en recentrant le traitement des dossiers sur les acteurs réellement engagés dans une démarche qualité.
Des critères d’enregistrement revus et durcis
Les articles R.6113-9 et R.6113-11 redéfinissent les attendus pour les demandes d’enregistrement ou de renouvellement au RNCP et au RS.
L’idée : passer d’une logique déclarative à une logique de preuve.
Désormais, les certificateurs doivent démontrer :
- L’analyse effective des promotions : une année complète de données pour une première demande, et une analyse rétrospective pour les renouvellements ;
- L’adéquation des moyens techniques, pédagogiques et d’encadrement, pour garantir la bonne préparation des candidats ;
- La cohérence entre les actions de formation et le référentiel de compétences visé ;
- L’intégration des enjeux sociétaux, notamment la transition écologique et numérique, la santé-sécurité au travail et la prise en compte du handicap.
Ces exigences traduisent une évolution vers un système plus mature, où l’impact réel de la formation sur l’emploi devient aussi important que la qualité de sa conception.
Trois refus en cinq ans ? Une mise en pause obligatoire
Autre innovation du décret : la création d’un “délai de carence” pour les certificateurs multipliant les échecs.
Selon l’article R.6113-11-1, un organisme ayant reçu trois refus d’enregistrement en cinq ans devra patienter un anavant de pouvoir déposer à nouveau une demande pour la même certification (ou une certification similaire).
Objectif : responsabiliser les porteurs de certifications et décourager les dépôts systématiques sans réelle mise en conformité.
Des habilitations mieux encadrées pour les partenaires
Le décret clarifie aussi la relation entre organisme certificateur et organisme habilité à former ou à évaluer.
Lorsqu’un certificateur ne dispense pas lui-même la formation ou l’évaluation, il peut habiliter des tiers, à condition que :
- cette habilitation fasse l’objet d’une convention formelle,
- qu’elle précise les certifications concernées, les moyens mis en œuvre, les durées, et les engagements de conformité aux référentiels,
- et que les organismes habilités respectent scrupuleusement les conditions de moyens, d’encadrement et de transparence exigées.
En cas de non-respect, France Compétences peut suspendre ou retirer l’habilitation, voire radier la certification correspondante.
Des contrôles renforcés et des sanctions graduées
Les nouveaux articles R.6113-16-7 à R.6113-16-13 détaillent un arsenal complet de contrôle.
France Compétences peut désormais :
- auditer les certificateurs sur pièces ou sur site ;
- mettre en demeure les structures non conformes ;
- retirer une certification du RNCP ou du RS ;
- et interdire tout nouveau dépôt pendant deux ans en cas de manquement grave.
Les cas les plus sévères — atteintes à l’intégrité morale ou physique des candidats, fausse communication, manquements déontologiques — entraînent des sanctions immédiates.
Une application progressive à partir d’octobre 2025
Pour laisser aux acteurs le temps de s’adapter, les dispositions du décret s’appliqueront :
- à toutes les demandes transmises à partir du 1er octobre 2025 ;
- et aux contrôles portant sur des faits postérieurs au 6 juin 2025.
Ce délai de transition doit permettre aux certificateurs de revoir leurs pratiques : mise à jour des référentiels, formalisation des habilitations, renforcement des indicateurs de suivi.
On vous en parle dans notre 👉 article dédié 👈
Conclusion
Il fallait un article au moins aussi conséquent pour balayer les principales actualités de la formation professionnelle.
👉 Vous souhaitez anticiper ces évolutions et transformer vos obligations qualité ?
Découvrez nos prestations d’accompagnement Qualité : diagnostic, mise en conformité, préparation et suivi Qualiopi, structuration de vos processus internes.
Contactez-nous dès maintenant et avançons sur vos projets qualité !